(adressez vos informations à l’ enfantcache@skynet.be )
LIVRES
- Alain Birenbaum, Salka, Simon, Herschel, Forest, 2019, 156 p
- Daniel Hanoch Wagner, Monsieur Benny, Dialogues inachevés, Collection Encres de Vie, L’Harmattan, Paris, 2017
Prof. H. Daniel Wagner, Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel, Tel: +972 8 934 2594 (w) http://www.weizmann.ac.il/materials/Wagner/
 |
- Nathalie Skowronek, La Shoah de Monsieur Durand, Gallimard, Paris, 20Prof. H. Daniel Wagner, Weizmann Institute of Science, r/
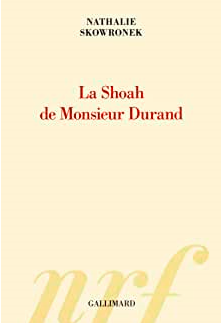
- Michel Kichka, Deuxième génération (Ce que je n’ai pas dit à mon père), Dargaud, 2012. Fils d’HenriKichka,réfugié à 15 ans, déporté à 16 ans, enfant
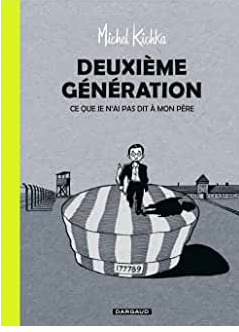
ARTICLES
Générations
Les enfants cachés et leurs enfants
par Adolphe Nysenholc
« De génération en génération » (en hébreu L’dor vador) est un chant traditionnel qui, ayant traversé les siècles, célèbre la fidélité d’Israël à sa Loi. Le génocide du siècle passé a voulu casser les maillons de cette chaîne venue de la nuit des temps, en massacrant un million et demi d’enfants juifs, l’avenir d’un peuple. Et depuis, la Shoah a laissé d’innombrables survivants sans reliance.
Mais comment transmettre en héritage qu’on a perdu tout lien, sa religion [1], sa famille, parfois jusqu’à son nom ? On crie zakhor, « souviens-toi », pour que « plus jamais ça ». On organise des commémorations. On érige des mémoriaux. On rédige des mémoires d’Histoire, et des récits de vie. Seulement, les narrations qui ne sont pas fortes d’une écriture, restent souvent lettres mortes. Le théâtre offre à cet égard une opportunité inespérée. Sur scène, les disparus, réincarnés en des acteurs, peuvent un moment revivre. Et c’est l’éternité retrouvée.
Mère de guerre
[1] Au sens du latin religare, (re)lier, si l’on retient cette étymologie.
La pièce Mère de guerre [1] fait ainsi renaître une mère, de nos jours. C’est la nuit. Un vieux fils est à l’agonie. Il a échappé jadis à la traque des nazis, jeune enfant. Il suffoque quand il voit revenir in extremis sa maman jeune, disparue en déportation des décennies plus tôt. Mais surgit aussi de l’ombre la femme âgée qui l’a recueilli dans l’urgence, décédée elle ensuite naturellement. La confrontation est insoutenable. Elles se disputent à son chevet, prétendant chacune être la vraie mère. Coupé des siens et élevé par des Gentils, il a vécu sans repères. Il reproche un moment à sa mère de l’avoir abandonné, comme s’il était encore le petit qui ne comprend pas comment on a pu le délaisser, et se demande aussi pourquoi l’autre, la vieille femme qui n’a pas eu d’enfant, l’a hébergé au risque de sa vie. La mère de guerre, c’est la marraine qui l’a sauvé, mais c’est aussi la mère morte de jalousie qui vient faire la guerre à celle qui a pu jouir de son fils toute sa vie. Le fils à l’heure dernière ne sait avec laquelle des revenantes il doit partir dans l’au-delà. S’en aller avec l’une, c’est trahir l’autre. Le personnage qui permet la réunion des protagonistes est le parrain, lequel était jadis maître de cérémonie des enterrements. Il précédait fièrement le corbillard tiré par les chevaux, coiffé d’un bicorne à cocarde et revêtu d’un costume noir aux revers chamarré de palmes d’argent. Lui qui menait de la vie à la mort, à présent il continue comme avant en menant les morts à la vie, pour une seule et unique fois. D’où ces rencontres improbables. Passeur, il participe au mythe de Caron ou d’Hermès psychopompe. Et il ramène à la lumière une jeune mère révoltée qui se révèle être une Antigone des camps.
Entre elle, quasi adolescente bloquée en l’année de sa mort, et le fils, qui a trois fois son âge, la différence est aussi grande qu’entre un grand-père et sa petite-fille, mais par rapport à l’événement même du génocide, ils sont tous deux de la première génération.
Si l’enfant n’avait pas échappé à la rafle, caché par des sauveurs, il aurait connu l’extermination avec sa mère et avec tous ceux qui étaient assassinés dès leur entrée à Treblinka, à Sobibor ou à Auschwitz. Ce n’est pas parce que l’enfant a survécu qu’il n’a pas subi la menace de mort. Comme juif, il était voué à la solution finale. Et devoir être caché, c’est ne plus oser vivre, faire de bruit ou respirer. Plus tard ce sera vivre avec la conscience de ce à quoi on a échappé. L’enfant qui n’a pas eu l’expérience directe des camps sentira de plus en plus la réalité concentrationnaire l’envahir au cours de son existence. Il devra continuer à vivre avec la mort de ses disparus, qui aurait aussi dû être la sienne. L’orphelin de la Shoah, dans la perte d’une famille nombreuse, se vit sans génération au-dessus de lui, comme s’il était né de génération spontanée. En tout cas, il demeure seul, en première ligne.
Longtemps, il ne pourra parler. A côté de l’adulte qu’il ne connaît pas mais qui est revenu des camps de la mort, sa parole n’a pas de poids. Son être n’a pas été éprouvé par l’enfer des centres d’extermination. « De quoi tu te plains, t’étais à la campagne », dit-on à l’un [2]. Il n’a rien à dire. Comme enfant caché, on n’était, pour les grands, qu’un planqué. Les adultes ont monopolisé tout le discours. Mais, comme ils commencent à disparaître, les enfants ont senti qu’ils avaient la responsabilité de prendre le relai de la mémoire.
Enfants de la paix
Et les voilà confrontés à leurs enfants [3], qu’ils ont traités quelque peu comme eux le furent. Car, ils les jugeaient de même : de quoi tu te plains, tu as des parents. Même si ce n’était pas dit explicitement, c’était le sous-texte de leur éducation. Certes, les enfants de la guerre ont pu avoir, au contraire, comme réaction avec leurs fils et filles : je n’ai pas eu ta chance d’avoir père et mère, mais je ferai tout pour ne pas te le faire sentir. Ce qui était encore une façon de transmettre leur carence affective. Mais, leurs propres enfants, même s’ils ont vécu dans la tendresse d’un foyer, savent qu’ils n’ont pas de grands-parents ou tantes et oncles. Ils revivent la souffrance de leurs parents, en manque de leurs aïeux. Ce serait la problématique d’un Henri Raczymow à « la mémoire trouée » [4], voire d’un Modiano, nés après la guerre.
Il est vrai, ceux-ci, enfants d’enfants survivants, ne risquaient pas de se retrouver dans les convois de la mort, d’être arrachés à leurs parents par la Gestapo, de vivre en clandestins hors de chez eux comme des marranes déchirés (juifs à l’intérieur d’eux-mêmes et chrétiens ou laïques à l’extérieur [5]). Leurs thématiques sont différentes de celles d’un Georges Perec, d’un Aharon Appelfeld, nés eux avant la guerre.
Les enfants venus au monde après 1945 ont certes pu éprouver les mêmes douleurs que les enfants cachés qui ont retrouvé parfois un parent rescapé, lequel, déprimé, était incapable de les élever, et qui transmettait, qu’il le veuille ou non, un passé lourd qui ne passait pas. Mais, ce serait abusif d’identifier ces fils et filles, qui ont vu le jour dans la paix, aux orphelins de la Shoah qui n’avaient trouvé aucune solution familiale. [6] Leur weltanschauung ne peut être la même. Déplorer avec une mère l’absence d’une grand-mère, ce n’est pas la pleurer seul.
Bubelè l’enfant à l’ombre
Quand on lit les autobiographies [7] de ceux qui ont été cachés enfants (pour éviter d’être emportés dans les trains de sinistre mémoire), on arrive à distinguer ce qui est spécifique à chaque génération. [8]
Les auteurs, qui ont vu le jour au lendemain de la Libération, reconstituent, vingt ans après, une Shoah imaginaire dans leurs livres, comme Place de l’étoile en 1968 [9]. Tandis que l’écrivain, qui a commencé sa vie dans la violence de la persécution, il témoigne, souvent des décennies bien plus tard, de faits traumatisants réels subis dans sa chair.
Seulement, si l’enfant de la guerre veut faire passer le message, être lu lui aussi, il doit tout autant sacrifier à l’art du récit. Il sait qu’il n’accrochera le lecteur que s’il s’adresse à son imagination. Conteur d’une terrible réalité, il ne peut échapper aux lois de la Fable. Son histoire ne sera vraisemblable que s’il retrouve la voix du mythe, c’est-à-dire une parole qui parle à l’âme. Il devra même, en poète, inventer, dans le sens de trouver le mot qui fait image, comme le faisait le trouvère ou le troubadour. Mais alors son texte risque d’être ressenti comme un tissu de mensonges et donner des arguments aux négationnistes.
L’écrivain, ancien enfant caché, doit résoudre l’impossible. Se raconter, c’est sortir de l’ombre. Mais se montrer, c’était naguère risquer sa vie. Aussi Perec se confesse avec une « écriture blanche », qui dit moins par crainte d’en dire trop [10]. On a de même le style dépouillé, voire désossé de Berthe Burko-Falcman [11], dont la fillette devient anorexique, comme si, par culpabilité d’avoir survécu, elle s’identifiait aux déportés décharnés, morts de faim. Que dire de Raymond Federman [12] qui évoque sa cache comme l’idiot, au début du roman de Faulkner, Le Bruit et la Fureur, avec des mots-rébus d’abord incompréhensibles, et qui expriment la panique du jeune garçon enfermé dans une armoire d’où il assiste impuissant à l’arrestation des siens. L’écriture peut être une carapace derrière laquelle l’écrivain-enfant se retranche. Par son style, il parle comme l’acteur antique portant un masque (« persona » en latin, terme qui signifie un porte-voix du verbe « per-sonare », sonner à travers). Il devient un personnage tragique, un médium qui dit la parole des morts.
Et pour se préserver, certains revendiqueront même le droit à la fiction, le « mentir-vrai » d’un Aragon, qui fait plus vrai que nature. Ainsi Aharon Appelfeld [13] avouait que s’il écrivait la réalité (son évasion d’un camp de rassemblement à l’âge de dix ans, comment il a survécu dans les bois de Bucovine, etc.) ce ne serait pas « crédible ». Il a pu se dire le jour où il a raconté son histoire à travers une petite fille figurant son double [14]. Louis Begley [15] qui a traversé toute la Pologne durant la guerre a dû mentir toute son enfance sur ce qu’il était pour ne pas être pris, et on exigerait de lui que quand il veut sauver sa vie en la faisant perdurer par un livre qu’il dise la vérité et rien que la vérité ? [16]
Et là se pose le problème des plus jeunes. Comment se souvenir qu’on fut abandonné dans un crèche, à peine né ? Il y a tout un pan de la Shoah qui ne sera jamais connu. Si ceux qui étaient à l’époque adolescents, ayant beaucoup de souvenirs [17], ont ensuite le souci de les rapporter le plus fidèlement possible comme Saul Friedländer, ceux qui étaient alors jeunes enfants [18] ont davantage tendance plus tard à se donner une enfance, qu’ils ne peuvent que fantasmer en grande partie. Mais est-ce parce que vous n’avez guère de souvenir précis que vous n’avez pas le droit d’attester un vécu qui a néanmoins existé ? C’est le parti-pris du roman d’inspiration autobiographique sur un enfant qui perd sa famille à l’âge de trois ans, Bubelè l’enfant à l’ombre [19]. Ce récit décrit les personnages de Mère de guerre, quand ils vivaient avec le petit au quotidien depuis 1942, l’année des rafles, jusqu’à la capitulation du Reich et même un peu au-delà.
Mais le point de vue y est celui de l’enfant. Tout ce que l’on sait et voit, c’est à travers les yeux du petit garçon. Il bouillonne d’une colère rentrée. Le vieux couple de Bruxellois flamands, qui l’a recueilli, l’apprivoise, le console, l’adore. Leur fille de 20 ans vient d’avoir une fille. Elle est pour le petit comme une grande demi-sœur, mais elle a quasi l’âge de sa mère à lui, qui l’a confié en désespoir de cause à ces gens. Pour le bambin, leur petite-fille d’un an est comme une sœur cadette. Mais pourquoi, se dit-il, elle, elle peut avoir une mère ? Il sent bien que ses parents de substitution sont en fait des grands-parents. Lui n’a jamais vu les siens d’aïeux, lesquels, vivant en Pologne, y disparaîtront avec toute la famille (des dizaines de personnes). Arraché à l’affection de ses parrains de guerre, il sera placé dans une maison d’enfants, où sera renouvelé son sentiment d’abandon.
La transmission de sa propre vérité se fait assurément dans la relativité d’un discours. Et la génération qui suit peut s’identifier par amour à la précédente, parfois jusqu’à en souffrir, voire jusqu’à la haïr pour devoir assumer une douleur que parfois elle rejette.
C’est en tout cas déjà la contradiction dans laquelle est piégé le fils survivant de Mère de guerre. Il se sent coupable d’en vouloir injustement à ceux qui auraient dû vivre pour lui et non mourir, il se punit en n’osant exister lui-même, mais s’indigne d’être condamné à une non-vie dans l’attente vaine de leur retour.
La littérature de l’Holocauste [20], qui atteste la coupure avec le Yiddishland détruit, en arrive, aux yeux d’israélites acculturés, laïcisés, assimilés, à oblitérer, par ses livres profanes, le Livre sacré, - l’Ancien Testament, - voire l’Alliance.
Les conséquences de la Shoah peuvent se comparer aux effets qu’a engendré l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima [21]. On eut des morts en masse comme au ground zero et moins de tués au fur et à mesure qu’on s’éloignait du point mort, et puis suivirent des générations touchées à des degrés divers par son rayonnement, comme s’il s’agissait d’une radioactivité qui contamine les corps et les esprits. [22]
Après la destruction du Temple de Jérusalem au premier siècle de l’ère chrétienne, par les Romains, - l’extermination du peuple de Dieu, en diaspora, au deuxième millénaire par les Germains, suscitera encore pas mal d’exégèses et de commentaires sur les rayons des bibliothèques, tant qu’il y en aura toujours des traces et même au-delà.
(paru dans Centrale, 2012 ) www.adolphe-nysenholc.be
[1] Adolphe Nysenholc, Mère de guerre, Ed. Lansman, 2006. La pièce a été représentée dans 7 pays en 4 langues, dont une séance au Yad Vashem à Jérusalem, en la salle Wyspianski de Cracovie, à l’Atelier Marcel Hastir, au Gong Theater de Sibiu, à Yale University.
[2] Marcel Frydman, Le traumatisme de l’enfant caché, L’Harmattan, 2002.
[3] Cf. Nathalie Zajde, Enfants de survivants, Editions Odile Jacob, 1995 et Guérir de la Shoah, Editions Odile Jacob, 2005.
[4] Un cri sans voix, Gallimard, 1985.
[5] Cf. Georges-Arthur Goldschmidt, La Traversée des Fleuves, Seuil, 1999 ; Saul Friedländer, Quand vient le souvenir, Seuil, 1978 ; qui, athées aujourd’hui, ont voulu à la fin de la guerre devenir l’un prêtre l’autre jésuite, par reconnaissance aux institutions religieuses qui les avaient sauvés.
[6] Cf. Annelise Shulte Norholt (éd.), Perec, Modiano, Racymow, La génération d’après et la mémoire de la Shoah, Rodopi, Amsterdam, 2008. On y parle pour les trois auteurs de « la génération d’après » la Shoah, alors que Perec est né en 1936, Modiano en juillet 1945, et Raczymow en 1948. A la limite, on pourrait croire que né après la Shoah c’est encore pire que pendant, sinon aussi mal. L’enfant caché, nié dans sa douleur par les adultes, l’est encore par des enfants qui le suivent, qui estiment souffrir parfois autant, ce qui n’est pas exclu, voire davantage.
[7] Particulièrement des biographies littéraires sur soi écrites par soi-même.
[8] Cf. le colloque que j’ai organisé à ce sujet à l’Institut d’Etudes du Judaïsme (ULB), Chaire des identités juives, « Autobiographies d’enfants cachés », du 6 février au 27 mars 2009.
[9] Patrick Modiano, Gallimard, 1968.
[10] Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, Denoël, 1975.
[11] Berthe Burko-Falcman, L’enfant caché, Seuil, 1997.
[12] Raymond Federman, La Voix dans le débarras, Les Impressions nouvelles, 2008.
[13] Aharon Appelfeld, Histoire d’une vie, Seuil, 1999.
[14] Aharon Appelfeld, Tsili, Editions de l’Olivier/Seuil, 2004.
[15] Louis Begley, War Time Lies (1989), Une éducation polonaise, Grasset, 1992, Prix Médicis.
[16] Cf. Adolphe Nysenholc (éd.), L’Enfant terrible de la littérature (autobiographies d’enfants cachés), Didier Devillez Editeur, Collection « Mosaïque », 2011.
[17] Nés dans l’Entre-deux-Guerres, ils fréquentaient l’école primaire ou secondaire.
[18] Nés aux environs de 1940, ils sont tout au plus à la maternelle..
[19] Adolphe Nysenholc, Bubelè l’enfant à l’ombre, L’Harmattan, 2007.
[20]Terme en usage dans le monde anglo-saxon et mot impropre, car, selon l’étymologie il désignerait un sacrifice au(x) dieu(x), on se demande par quels prêtres.
[21] La comparaison a ses limites. Dans la destruction de cette ville, il n’y a pas eu l’intention d’anéantir le peuple nippon ni sa culture comme ce fut le cas du judéocide. Ce qui n’enlève rien à l’horreur de ce crime de guerre et contre l’humanité.
[22] Yolanda Gampel, in L’Ange exterminateur, Perel Wilgowicz, J. Gillibert, A. Nysenholc (éds), Revue de l’Université de Bruxelles, 3-4, 1993, p. 173.
